Pastorale américaine de Philip Roth est le 22e (!) livre de l’auteur juif américain de « Goodbye Colombus » du Complexe de Portnoy ou encore de « La tâche », écrit à soixante ans passés et paru aux Etats-Unis en 1997. Il inaugure une trilogie sur le rêve américain, ses illusions de grandeur, de bonheur fait de fragiles images d’épinal et ses grandes espérances…, complétée des ouvrages « J’ai épousé un communiste » (1999) et de « La tâche » (2002). Une fresque réaliste de l’histoire tumultueuses et des tribulations de son pays.
Avec ce premier opus Roth rafle au passage le prix Pulitzer et en France, le titre du Meilleur Livre étranger en 2000. Au prétexte d’une nouvelle investigation de son double Nathan Zuckerman, omniprésent dans son œuvre, il retrace la destinée d’un de ses camarades de classe et voisin de quartier dans le Newark d’avant guerre. A travers cet homme « programmé pour le rêve américain », il dépeint les deux décades les plus corrosives de l’histoire des Etats-Unis, celles des années 60-70 ou, comment, derrière la façade brillante de la prospérité et du bonheur à l’américaine, il suffit d’une petite fissure pour que tout s’effondre avec fracas et plonge les destinées dans un chaos insoupçonnable… Au delà de ce thème désormais classique de la littérature et du cinéma indépendant américain, Roth brosse un portrait poignant de la relation père-fille après avoir relaté dans « Patrimoine » en 1994 sa propre relation avec son père de 86 ans mourant…
« Il venait d’être initié à un secret plus déconcertant encore que le bégaiement de Merry : la vie ne parlait jamais couramment nulle part. Tout bégayait. La nuit, dans son lit, il se représentait toute sa vie comme une bouche bègue, comme un visage grimaçant – elle n’avait ni queue ni tête cette vie, elle partait à vau-l’eau. Il n’avait plus aucune notion de l’ordre. Il n’y en avait pas d’ordre. Aucun. Sa vie était une pensée de bègue, elle divaguait, elle échappait à son contrôle.«
« La vie d’Ivan Ilitch avait été très simple, très banale, et par conséquent tout à fait effroyable.«
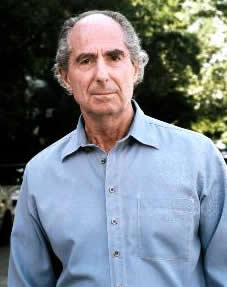 Sur plus de 400 pages, Philip Roth, nous entraîne donc sur les pas d’un homme. Un américain d’origine juive : Seymour Irving Levov, juif blond aux yeux bleus de Newark, surnommé «le Suédois».
Sur plus de 400 pages, Philip Roth, nous entraîne donc sur les pas d’un homme. Un américain d’origine juive : Seymour Irving Levov, juif blond aux yeux bleus de Newark, surnommé «le Suédois».
Il retrace le tourbillon de sa vie, de son passé surtout. Construit sur le mode du flash back et des aller-retours permanents entre le présent et ses souvenirs qui le hantent, il remonte à ses origines, son adolescence flamboyante où il était le champion de base ball adulé de tous. Un héros. Un vrai. « L’étoffe même de l’Amérique ». Mais l’Histoire peut parfois être cruelle même avec les héros…
Devenu un brillant homme d’affaires, honnête commerçant, travailleur acharné, fils reconnaissant de son père qui lui a « tout appris » et dont il a repris l’usine de ganterie, il a de plus épousé, pour parfaire le tableau doré, la plus belle fille du conté, ex miss New Jersey, qui lui a donné la fillette la plus adorable qui soit. Les violons de la pastorale ne cessent de jouer harmonieusement.
Mais derrière cette prospérité, ce bonheur d’apparat, se profile l’envers du décor. Celui qui se révèlera à l’adolescence de sa fille. Sa propre progéniture qui fera s’écrouler cette mécanique bien huilée de l’intégration et de l’ascension sociale. Décidant de se rebeller contre la société matérialiste, impérialiste et capitaliste incarnée notamment par son père, elle s’engage à seize ans pour la cause nord-vietnamienne. Embrigadée dans un militantisme de plus en plus extrémiste, elle ira jusqu’à poser une bombe avant de sombrer dans la clandestinité et l’endoctrinement d’une secte indienne.
« Or survient la fille perdue, la fille en cavale, cette Américaine de la quatrième génération censée reproduire en plus parfait encore l’image de son père, lui-même image du sien en plus parfait et ainsi de suite… survient la fille en colère, la malgracieuse, qui crache sur son monde et se fiche éperdument de prendre sa place dans la lignée Levov en pleine ascension sociale, sa fille, enfin, qui le débusque comme un fugitif, qui le pousse la première dans la transhumance d’une tout autre Amérique; sa fille et ces années soixante qui font voler en éclats le type d’utopie qui lui est cher, à lui. Voilà la mort rouge qui contamine le château du Suédois, et personne n’en réchappe. Voilà sa fille qui l’exile de sa pastorale américaine tant désirée pour le précipiter dans un univers hostile qui en est le parfait contraire, dans la fureur, la violence, le désespoir d’un chaos infernal qui n’appartient qu’à l’Amérique. »
Dés lors, le «Suédois» vivra une double vie : d’une part celle des apparences, à sauvegarder coûte que coûte dans la société, et d’autre part celle de tenter de sauver sa fille du cauchemar dans lequel elle s’enfonce, persuadé qu’elle est manipulée : « Pourquoi fallait-il toujours qu’elle aliène son libre arbitre à la première idée débile qui traînait ? Dès qu’elle avait été assez grande pour penser par elle-même, elle s’était laissé tyranniser par des idées de cinglés. Pourquoi une fille aussi intelligente faisait-elle tout son possible pour laisser autrui penser à sa place ? »
Dans la grande tradition des romans américains que l’on pourrait qualifier de la « fêlure » selon l’expression chère à Fitzgerald, Pastorale américaine fait partie des classiques de ce genre consistant à révéler l’envers du décor, les fissures et les failles qui se cachent derrière le vernis brillant des façades des pavillons proprets et des familles parfaites.
Aux côtés d’auteurs comme Jeffrey Eugenides (Virgin suicides), d’un Moody (« Démonologie, « Le voile noir »…) ou d’un Franzen (« Les corrections ») ou plus récemment encore d’un Tom Perrotta (« Les enfants de choeur »), Roth raconte le leurre constitué par le « rêve américain », ce mythe qui repose sur cette trilogie matérialiste : « Le travail, l’épargne, la réussite. » Roth s’emploie à le dynamiter petit à petit, à pas feutrés, en déchirant peu à peu le voile de « l’ascension social » et de la parfaite intégration derrière lequel se masque son héros, son père et son grand-père : « Trois générations en extase devant l’Amérique. Trois générations pour se fondre dans un peuple. Et maintenant avec la 4e, anéantissement des espoirs. Vandalisation totale de leur monde. » Il dessine, ce faisant, un portrait trans-générationnel et interroge les thèmes de la transmission, du patrimoine, de l’héritage en particulier culturel et intellectuel, des valeurs.
« S’il avait pu de nouveau fonctionner comme tout un chacun, redevenir tel qu’en lui-même, au lieu d’être ce charlatan à la sincérité schizophrène, lisse dehors, tourmenté dedans, stable aux yeux d’autrui, et pourtant le dos au mur en son for intérieur, puisque son personnage social détendu, souriant et factice servait de linceul au Suédois enterré vivant. »
Un peu avant l’heure des school-shootings qui donneront naissance à différents romans (dont le plus connu est peut-être celui de Lionel Shriver), il inaugure un autre genre, celui de l’introspection parentale pour tenter de comprendre l’incompréhensible et l’inacceptable : les crimes de son enfant et sa déchéance. Entre doutes, questionnement et surtout culpabilité, ce père meurtri se remémore l’enfance et l’adolescence de cette fille tant chérie, tentant d’identifier le grain de sable qui aurait fait dérailler cette belle mécanique génétique… Des souvenirs, des détails s’affrontent au fil des pages : l’éducation, les rapports (trop ?) fusionnels entre le père et la fille, les complexes hérités d’une mère trop obsédée par sa beauté ? (« C’est l’histoire d’une fille humiliée par sa reine de beauté de mère. », « Une mère qui a colonisé l’image de sa fille » comme l’accuse Rita Cohen, l’espionne envoyée par sa fille).
« Quelle était la nature de ces griefs, de cette rancune ? C’était le nœud du mystère. Comment Merry était devenue ce qu’elle était ? » : Trouver le ou la responsable, les causes, le faux pas, l’erreur qui ont entraîné ces terribles conséquences devient une obsession…
Expliquer l’inexplicable.
« Je me sens solitaire », lui disait-elle quand elle était toute petite, et ne réussit jamais à deviner où elle avait attrapé ce mot. Solitaire. Comment imaginer un mot plus triste dans la bouche d’une enfant de deux ans ? mais elle savait dire tant de choses si jeune, elle avait appris à parler si facilement, au début, si intelligemment – peut-être était-ce la cause de son bégaiement, tous ces mots qu’elle connaissait mystérieusement avant que les autres enfants en soient capables d’articuler leur propre nom, peut-être était-ce la charge émotive trop lourde d’un vocabulaire qui comporte la phrase « je me sens solitaire ». »
A travers ce roman Roth pose aussi la question taboue du reniement de son propre enfant. Peut-on toujours aimer et accepter son enfant après toutes ses trahisons et souffrances ? La réponse est affirmative : « Pas davantage il n’aurait pu dire qu’il haïssait sa fille pour ce qu’elle avait fait – si seulement il avait pu ! Si au lieu de vivre tiraillé entre le monde qu’elle n’habitait plus, celui qu’elle avait habité et celui qu’elle habitait peut-être, il était parvenu à la haïr assez pour se moquer éperdument de son monde, aujourd’hui comme hier ! »
On trouve ainsi de poignants passages sur la paternité : « La fente, comme tracée au tire-ligne, cette superbe couture rabattue, qui s’épanouira un jour en pétales et, au fil du temps, deviendra le con de la femme, un pliage d’origami. Le nombril improbable. Le torse géométrique. La précision anatomique de la cage thoracique. La souplesse de sa colonne vertébrale. Les crêtes osseuses de ses vertèbres, lames d’un petit sylophone. L’adorable dormance de ses seins invisibles avant le bourgeonnement. Toute la turbulence de ce qui veut advenir encore dans les limbes béats. Pourtant, dans le cou, sur le socle du cou duveteux, d’une certaine façon, la femme est déjà là. Le visage, sa gloire.
(…) Alors que rien n’est encore défini, le temps est si puissamment présent sur son visage. Le crâne est mou. L’ouverture des narines molles, c’est là tout le nez. La couleur de ses yeux. Sa blancheur, blanche, blanche. Le bleu limpide. Des yeux sans nuage. Toute sa personne est sans nuages, mais les yeux surtout, des fenêtres, des vitres lavées, qui ne révèlent encore rien de l’intérieur.
L’insouciance, l’abandon de ce corps dans ses bras. L’abandon du chaton à son père tout-puissant, géant rassurant. Il déborde d’un désir de protection… »
ou encore : « il débitait le sapin de Noël et le faisait flamber, en une seule fois, de sorte que les branches sèches comme de l’amadou s’enflammaient avec un grand soupir ardent, des craquements terribles, et que des ombres dansantes, petits démons espiègles, partait à l’assaut des quatre murs et du plafond, pour la plus grande terreur et la plus grande joie de Merry. » Il évoque aussi l’héritage paternel de ce père, à travers ses propres père et grand-mère : « Ces hommes à l’intelligence bornée, mais à l’énergie sans limites (…), ces hommes pour qui la chose la plus importante de l’existence était de continuer à vivre quoi qu’il arrive, étaient nos pères ; nous avions pour tâche de les aimer. »
Des hommes tout entiers voués à leur travail, celui des tanneries et de la ganterie. Il nous entraîne ainsi dans ce monde artisanal et nous communique, avec un certain lyrisme, sa passion. On retient plus particulièrement les descriptions lors de la visite de l’entreprise et de ce « lieu magique entre tous », en fin de parcours : « Les ouvriers donnaient leur forme à chaque gant et le repassaient en l’enfilant avec soin sur les mains de laiton, vernies de chrome et chauffées à la vapeur. Les mains étaient dangereusement chaudes, luisantes, dressées sur un rang depuis la table, maigres comme des mains mutilées, aplaties puis amputées – de jolis petites mains amputées qui flottaient en suspens comme les âmes des morts. »
Il tisse ainsi en filigrane un parallèle entre ce métier et les parcours de vie/mentalités :
« Tout ce qui vous intéresse, c’est la peau ! L’épiderme, la surface. Mais alors ce qu’il y a en dessous, zéro !«
ou encore à propos de la technique de fabrication des gants : « Un point manqué peut devenir une couture ouverte, mais ça ne se voit pas si on n’enfile pas la forme dans le gant pour tirer sur la couture, disait-elle à l’enfant. Il y a des trous dans les piqûres qui ne devraient pas s’y trouver parce que la piqueuse a raté un point et qu’elle a essayé de continuer comme si de rien n’était. » (…) « le cuir ne va pas forcément se déchirer quand on passera la forme, mais il risque de le faire plus tard quand la personne le mettra. »
Petite, sa fille Merry démontrait un attachement à ce patrimoine familial avant de le renier durement : « Merry passant d’un étage à l’autre avec une légèreté de moineau et une fierté de propriétaire, faisant étalage de sa familiarité avec tous les employés, ignorant encore que l’exploitation éhontée du travailleur par le patron avide qui accapare les moyens de production est une insulte à la dignité humaine. » Il engage ainsi une réflexion sur les classes sociales et la notion d’ascension. Il décrit d’ailleurs son épouse comme « une irlandaise en voie d’embourgeoisement, assez douée pour singer les manières d’une classe qui n’était pas la sienne. », une femme qui aurait honte de ses origines sociales.
Enfin Pastorale américaine pourrait presque être qualifié de roman historique tant il est ancré dans l’histoire de son pays : depuis l’effondrement du radieux Kennedy jusqu’au départ des GI pour le Vietnam. Le destin des personnages est radicalement transformé et ravagée par cette histoire sanglante : clandestinité, gauchisme new-yorkais, haine viscérale des parents, suppôts de Johnson, puis, pour finir, délire religieux.
Le roman est porté de bout en bout par sa construction narrative originale. En alternant présent et passé, le roman est une valse de souvenirs et de chocs entre ce qui a été et n’est plus. Cette construction en mille-feuilles permet de déployer différents niveaux et perspectives de lecture. Servi par le style riche et naturaliste de Roth, il fouille jusqu’aux tréfonds l’âme de ce père ayant engendré une meurtrière. Il convoque avec vigueur, la rage, l’humiliation, la frustration et l’angoisse d’un homme châtié bien qu’il se sente innocent. On pourra néanmoins lui reprocher quelques longueurs liées aux redondances qui traversent le roman, comme une marée qui reflue incessamment. Au delà de cette analyse psychologique, Pastorale américaine apparaît comme le roman du chaos intérieur et de la désintégration d’un mythe. Entre fresque et satire, une œuvre ténébreuse, puissante, inspirée et fascinante.













Derniers commentaires