 La Confession de Claude est le premier roman d’Emile Zola, publié en 1865 à l’âge de 25 ans (après avoir fait paraître son recueil de nouvelles/chroniques « Contes à Ninon » en 1864), alors qu’il exerce comme critique littéraire. Même si relativement méconnu et oublié aujourd’hui (hormis comme objet d’étude des chercheurs universitaires ou les curieux, amateurs du maître littéraire), il reste une œuvre intéressante à plusieurs titres : d’abord bien sûr au titre de débuts littéraires portant en germe certains thèmes et le style de l’œuvre magistrale à venir (même si Thérèse Raquin en est plus annonciateur) et nous fait découvrir le Zola jeune écrivain aspirant à l’écriture, le personnage principal « soupçonné » d’être son alter-ego tente d’écrire également (même si le thème n’est ici plus qu’une toile de fond car c’est avant tout de son « cœur » et de ses premiers émois amoureux sous le signe de « l’union fatale » selon ses termes que le narrateur nous entretient ).
La Confession de Claude est le premier roman d’Emile Zola, publié en 1865 à l’âge de 25 ans (après avoir fait paraître son recueil de nouvelles/chroniques « Contes à Ninon » en 1864), alors qu’il exerce comme critique littéraire. Même si relativement méconnu et oublié aujourd’hui (hormis comme objet d’étude des chercheurs universitaires ou les curieux, amateurs du maître littéraire), il reste une œuvre intéressante à plusieurs titres : d’abord bien sûr au titre de débuts littéraires portant en germe certains thèmes et le style de l’œuvre magistrale à venir (même si Thérèse Raquin en est plus annonciateur) et nous fait découvrir le Zola jeune écrivain aspirant à l’écriture, le personnage principal « soupçonné » d’être son alter-ego tente d’écrire également (même si le thème n’est ici plus qu’une toile de fond car c’est avant tout de son « cœur » et de ses premiers émois amoureux sous le signe de « l’union fatale » selon ses termes que le narrateur nous entretient ).
Mais aussi parce qu’il rappelle que Zola a débuté en écriture dans le registre intimiste alors qu’il est, paradoxe amusant, reconnu aujourd’hui pour être emblématique de son exact opposé à savoir le « grand roman d’imagination ancré dans le social et le politique » (vous savez tout ce blabla dont aiment se gargariser ceux qui prétendent connaître la « grande et vraie littérature » ). Ce qui montre bien que les deux sont intimement liés et qu’il n’y a pas d’opposition à faire entre ces deux « genres » (l’intime étant d’ailleurs omniprésent dans les romans de Zola et lui donnent toute leur valeur et puissance).
L’ambition romanesque de l’auteur des futurs Rougon-Macquart est d’ailleurs formulée prophétiquement -et magnifiquement- par le jeune Claude et sonne comme un manifeste littéraire d’avant les soirées de Médan : « Ce monde est poignant, l’étude en est âpre, pleine de vertige. Je voudrais pénétrer dans les cœurs et dans les âmes ; je suis attiré par ces femmes et ces hommes qui vivent autour de moi ; peut-être, au fond, ne trouverais-je que de la fange, mais j’aimerais à fouiller au fond. Ils vivent une vie si étrange, que je crois toujours être sur le point de découvrir en eux des vérités nouvelles. » On notera aussi sa réflexion relative à la « triste puissance du rêve » où il évoque sa faculté à matérialiser en son esprit des scènes qui le torturent.
Portrait de femmes déchues

Portrait d’Émile Zola (1868) par Édouard Manet
Très présent aussi et peut-être défaut de jeunesse qui sera gommé -plus ou moins- progressivement dans ces livres à venir, un ton lourdement moralisateur, s’articulant autour d’une dichotomie constante voire pesante entre le vice et la vertu, la pureté et la débauche, l’innocence et la souillure, la blancheur (« une amante blanche lumineuse ») et la noirceur, où la sexualité des femmes (« honteuse ») est sans cesse condamnée et déplorée par le narrateur romantique idéaliste.
Obsession de la pureté virginale féminine
Son appel désespéré à la virginité féminine et à la « pureté », emprunt de morale judéo-chrétienne, de rêve d’oie blanche soumise sortie des couvents (« elles n’ont plus la sainte ignorance« ) et de lyrisme ampoulé (avec ses références appuyées à ses « frères », procédé narratif pas toujours très fluide non plus…) et autres clichés, finit par peser lourd : « je vous parlais de la femme ; j’aurais voulu qu’elle naquît pareille aux fleurs sauvages, en plein vent, en pleine rosée, qu’elle fût plante des eaux, qu’un éternel courant lavât son cœur et sa chair. Je vous jurais de n’aimer qu’une vierge, une vierge enfant, plus blanche que la neige, plus limpide que l’eau de source, plus profonde et plus immense en pureté que le ciel et la mer. » ; « un saint désir, avide d’innocence, de blancheur immaculée » (l’utilisation de « saint » ici au sens de sacré fait aussi écho à celui de « sain » alors que se développe plus que jamais le discours médical bourgeois sur la sexualité comme l’a démontré Foucault ; « ma vierge enfant ». Allant jusqu’à une mièvrerie un peu écœurante telle que : « mon cœur avait besoin de pureté et de virginité, et que j’aimais la neige, parce qu’elle était blanche… » ou confine même à la psychose effrayante (« désir insatiable de viriginité« ) ou à la folie/délire mystique comme vers la fin du roman. Non, Claude ce n’est pas sale 🙂
On retrouve ici des relents du thème éternel de l’homme cherchant à confiner et sculpter la femme à l’image de ses fantasmes et exigences (cf. mythe de Pygmalion) en la chosifiant, doublée de l’idée de possession et de conquête d’une terre vierge. Aux yeux de Claude, Laurence n’existe pas en tant qu’être à part entière mais n’est qu’une toile où il projette ses attentes/exigences personnelles sans se préoccuper des siennes. Il ne voit ainsi en elle qu’un objet à réformer, à re-façonner, y compris contre son gré (on rejoint ici d’une certaine façon la littérature traditionnelle de la réformation/rédemption de la femme déviante par un mentor car non conforme aux conventions sociales en particulier de soumission à l’autorité masculine, particulièrement florissante dans la 2e moitié du XVIIIe s.).
Le terme d’ »enfant » récuremment utilisé pour évoquer les personnages féminins dénote aussi de cette volonté masculine typique de maintenir la femme à l’état infantile pour mieux la soumettre, ce que Napoléon consacre dans son code civil en la déclarant éternellement mineure d’un point de vue juridique… Il fait ainsi contraster l’apparence ou l’esprit encore juvénile de ces femmes avec leur corps d’une maturité « sexuelle » honteuse : « l’intelligence et le cœur sont restés chez elle en bas âge, tandis que le corps grandissait et se souillait. Elle a une naïveté exquise, horrible parfois, lorsque, avec un doux sourire et de grands yeux étonnés, elle laisse échapper de grossières paroles de ses lèvres délicates. »
Ainsi il n’assume pas son couple avec Laurence ni la tendresse voire l’amour qu’elle pourra lui inspirer progressivement (même si ce dernier tient plus de la pulsion possessive égoiste comme il le reconnaît d’ailleurs : « défendre mon bien« ), qu’il rejette, qu’il méprise finalement et dont il a honte, ne parvenant pas à s’affranchir des injonctions sociales qui veulent que la sexualité d’une femme ne puisse être qu’un stigmate : « c’est Laurence, c’est l’infamie, ce sont mes tendresses pour cette femme. » ; « Laurence est une âme souillée à jamais ».
La conclusion du roman va d’ailleurs dans ce sens avec Claude affirmant que « Laurence est mauvaise » et même lui faisant reconnaître cet état de fait (en ligne avec la représentation historique de la femme dans les écrits masculins, comme « mauvaise » et fautive donc, cf. mythe de la pécheresse originelle, Eve). La rédemption de la femme ne pourra intervenir que dans sa mort, alors qu’elle devient « ange » telle Marie (cf : « l’ange de la maison victorienne »). De son côté l’homme même profitant d’une pauvre fille ou se livrant à l’adultère (cf. Jacques) reste digne et moral et obtient donc le pardon du héros à la fin.
Marie éveille les mêmes commentaires et réflexions chez lui autour de la traditionnelle dichotomie vierge et putain : « la jeunesse de ses regards et la vieillesse prématurée de son sang, je me disais qu’elle allait mourir de décrépitude à quinze ans, vierge d’âme. Émaciée et affaiblie, elle s’étendait comme une courtisane et souriait comme une sainte ; » « à tout son être, je voyais l’innocence de son cœur et la honte de son corps » ; « Elle avait fait le mal avant de savoir que le mal existait aujourd’hui, en pleine débauche, elle gardait son visage d’enfant, n’ayant jamais cessé d’être vierge et innocente. »
Des jugements aux relents puritains qui ont, j’ai envie de vous dire -optimistiquement-, mal vieilli, mais peut-être pas tant que cela quand on voit que le slut-shaming et la culpabilisation corporelle et sexuelle des femmes continuer de prospérer dans les médias et dans les commentaires sur Internet…
On notera aussi couplée à l’obsession de la virginité, celle de la jeunesse (qui va de pair) et l’effroi provoqué par la vision d’un corps ou d’un visage de femme vieillissants ou encore pire d’une femme âgée (cf. Pâquerette dont le baiser le répugnera notamment).

Émile Zola vers 1862, à l’âge de vingt-deux ans.
Zola, peintre de tableaux aux atmosphères sensorielles
Le jeune Claude qui perdra d’ailleurs sa virginité à son grand regret avec la « femme publique » qu’est Laurence, n’a de cesse de se désoler de ces femmes dont le corps est exploité et abusé par les hommes, et même s’il est conscient de leur statut de victime dans cette situation, il ne peut s’empêcher de leur en vouloir inconsciemment, des vouloir les « condamner »selon son expression et donc de les rendre aussi coupable d’une certaine façon. Ce jugement implicite (et même explicite d’ici la fin du roman « il faut donc tuer les Laurences » gloups !) même si ambivalent (mêlé à de la pitié) peut rendre ses propos assez dérangeants et irritants parfois outre l’excès de lyrisme dont ses complaintes sont parfois empruntes (ce qui n’empêche pas de savourer déjà le style assez virtuose de l’auteur en particulier dans ses descriptions riches en détails sensoriels qu’il s’agisse de dépeindre sa mansarde nue et misérable qui devient quasiment mystique au moment où il s’y trouve reclus privé de vêtements notamment, une scène de bal qui prend des allures fantastiques et en préambule la préparation de Laurence qui se « peint » et s’apprête avec un regard aigu sur le corps féminin et sa décrépitude, sa vulnérabilité, le mélange de femme-enfant et de femme fatale, ou encore ses souvenirs de jeunesse dans une campagne enchantée).
Sa capacité à décrire des sentiments complexes et ambigus, tels ceux qui hantent l’anti-héros, et à dévoiler une grande profondeur psychologique sont déjà aussi parfaitement en place (« il y a dans la misère une sorte d’ivresse lourde, une somnolence voluptueuse qui endort la conscience, la chair et l’esprit »). La rencontre avec Laurence, telle une Belle au Bois dormant déchue, suscitant attraction et répulsion chez le jeune-homme inexpérimenté (« Laurence qui m’effraie et m’attire »), tient aussi de l’onirique teinté de noirceur et illustre déjà le talent pictural de l’auteur virtuose (et très proche des peintres impressionnistes) pour figurer dans l’imaginaire de ses lecteurs des toiles à la composition frappante.
Il fait aussi déjà le choix de décrire une réalité sans fards, sans chercher à embellir ou ennoblir les faits et les âmes. Sa tentative de rédemption de Laurence -façon Marie-Madeleine- échoue d’ailleurs lamentablement et il se trouve même sous son emprise au lieu d’exercer l’influence qu’il avait espéré (cette volonté d’aller à contre-courant du mythe de la femme « de mauvaise vie » ramenée dans le droit chemin par la passion se trouve explicité dans une de ses lettres de 1860 à son ami Baille où il traite aussi de la « désillusion de l’amour »). On note que c’est finalement uniquement la nature qui parviendra à « purifier » Laurence aux yeux du narrateur lors de leur après-mmidi dans la campagne environnant encore Paris (intéressant voyage dans la banlieue parisienne du XIXe siècle encore (semi-) préservée de l’urbanisation effrénée, rappelant la scène de canotage dans Thérèse Raquin du côté de saint Ouen, et aussi rare moment d’acalmie et de joie dans ce roman dramatique).
Le personnage démnote aussi par son hyper-sensibilité mise à nu dans la pure tradition romantique contre laquelle Zola s’érigera pourtant par la suite en particulier pour ses excès. On pense à un Werther (1774) ou à un Adolphe de Benjamin Constant (1816). Il se reconnaît ainsi ouvertement comme créature larmoyante, aux sentiments exacerbés, un aveu assez étonnant en ce XIXe siècle qui tente d’éradiquer et craint les valeurs dites « féminines » dont la sensibilité et les larmes sont le premier « symptôme » à la fois admiré et décrié (cf. la démultiplication des duels et autres démonstrations « viriles » d’attitude combattante, sur fond de conquêtes coloniales) et n’hésite pas à dévoiler sa souffrance intérieure ou à se livrer à de profondes introspections :
« Je dois être une créature étrange, bonne seulement à aimer et à pleurer, car je me suis attendri, j’ai souffert dès mes premiers pas. »
« Je n’avance qu’en chancelant ; je n’ai pas pour me protéger cette belle tranquillité, ce silence du cœur et de l’âme. Je suis tout chair, tout amour, je me sens vibrer profondément à la moindre sensation. »
Il va même jusqu’à déclarer sa faiblesse, sa crainte de la solitude de façon assez poignante, redevenant ainsi plus « humain » et moins moralisant.
Jacques (qui incarne son opposé « froid » et « raisonneur ») dans sa confrontation de fin avec lui, dénoncera d’ailleurs explicitement cette « anomalie » de genre : « je n’ai pas tes nerfs de femme, ton âpreté ni ta délicatesse de sensation. »
On s’agacera toutefois aussi de sa tendance à vouloir jouer les « coeurs purs indignés dans une société/Paris dépravé(e) » (« la boue », la « fange » qu’il ne cesse de dénoncer) dont la tirade de fin de Jacques l’apparentant quasiment à un « saint » constitue l’apothéose assez ridicule. Il va jusqu’à se prendre pour un martyre avec la comparaison récurrente des plaies saignantes.
L’extrémisme et le dogmatisme du personnage finissent par lui faire perdre toute crédibilité en le rendant malheureusement grotesque.
Conclusion :
La Confession de Claude d’Emile Zola tient donc de la curiosité littéraire, sans doute un peu datée aujourd’hui du fait de sa lourde insistance morale sur la virginité féminine -même si en cohérence avec les idéaux de pureté du personnage- et son manichéisme (défaut que Zola gommera heureusement par la suite). Le côté larmoyant et plaintif voire fataliste de ses suppliques pourront aussi sembler quelque peu répétitif et excessif. L’ouvrage vaut malgré tout comme témoignage du malaise masculin face à l’émancipation des femmes en particulier sexuelle. La maîtrise stylistique et de nombreuses scènes (évoquées ci-dessus) et réflexions méritent ainsi l’attention. La voix de l’auteur qui sait capter l’intérêt du lecteur est déjà puissante et efficace même si le style introspectif/confessionnel avec de rares dialogues directs (qui tiennent plus du monologue) ni « péripéties » rend peut-être l’œuvre moins facile d’accès et plus « élitiste » comme le veut le genre (ce qui peut expliquer son moindre succès et oubli). Il n’empêche qu’on souhaite aller jusqu’au bout de ses confessions et de cette relation maudite dans laquelle le jeune-homme s’enlise avec une « volupté amère« . [Alexandra Galakof]

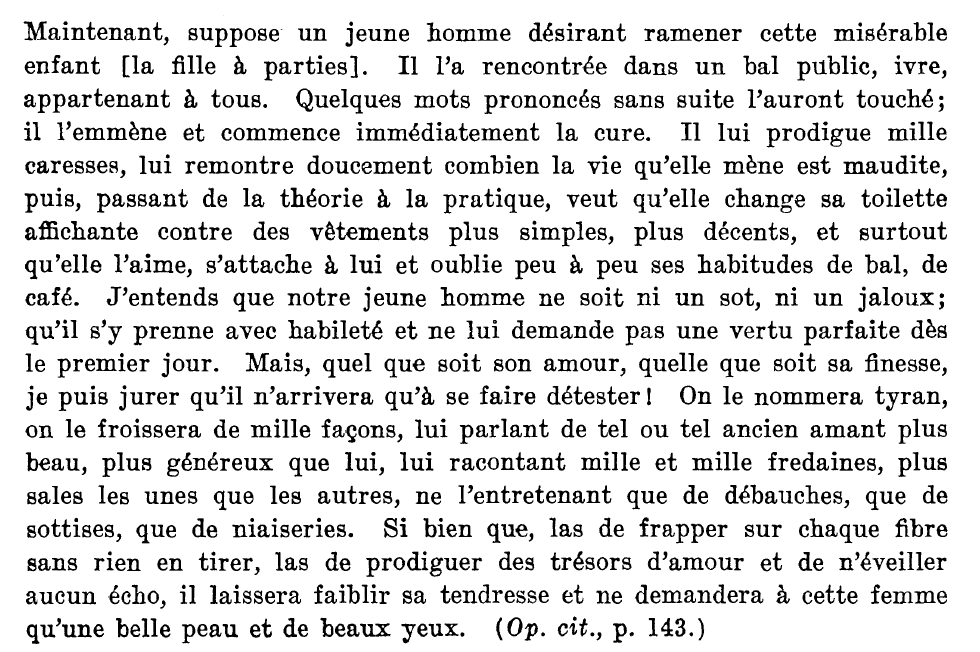












5 Commentaires
Passer au formulaire de commentaire
Incroyable ! Je n’avais jamais entendu parler de ce roman, pourtant j’ai déjà lu quelques Zola. Le premier roman d’un grand écrivain est toujours passionnant. Ici, ca m’a l’air bien déroutant, notamment à cause du « je » encore jamais rencontré chez Zola. Excellent article.
eh oui c’est une petite curiosité méconnue, ça vaut le coup si on est curieux et si on est pas allergique au genre intimiste. j’avoue que même en étant amateur du genre, j’ai trouvé des longueurs à certains passages et monologues mais ça vaut le coup d’aller jusqu’au bout en particulier si on s’intéresse à la vision des femmes (ambivalente) de Zola.
http://www.buzz-litteraire.com/vision-de-femme-emile-zola-collaboratrice-de-lhomme-loeuvre-commune-compagne-fidele-lappui-certain-legale-conciliante-devouee/
A noter que Zola avait 25 ans quand il a écrit ce premier roman déjà très abouti malgré petits défauts évoqués… J’ai pensé un peu aussi aux carnets du sous-sol de Dostoievski avec ces anti-héros masculins désillusionnés par leur époque et leur société, écorchés vifs avec un complexe de supériorité/infériorité (les 2 allant souvent de pair 🙂
http://www.buzz-litteraire.com/notes-dun-souterrain-carnets-du-sous-sol-de-f-dostoievski-cest-que-je-ne-peux-pas-vivre-sans-exercer-ma-puissance-et-ma-tyrannie-sur-quelquun/
Cher Madame,
Apres lire « La Confession », c’etait tres informatif votre « essay », parce-que je voudrait savoir que cet roman voulait dire. C’etait une epreuve de le lire, la langue est tres veilli et en extase. La vision (comme vous montree) sur femmes dans cette epoque est choquante, et domine aussi Les Rougon Macquart. Je lis tous le cycle des romans (en traduction Neerlandais) maintenant (deja 10!). Il existent beaucoup traductions en Neerlandais, dans le passee, mais de temps en temps encore nouveau traductions. Zola est encore populair.
Excuse pour mon pauvre francais!
Jan Buter, Amsterdam
Auteur
Merci Jan et bravo pour votre français et vos efforts.
Ce premier roman est un peu à part dans la bibliographie du maître mais vous avez raison on y retrouve ses conceptions de la femme même s’il a toujours eu de l’empathie pour les femmes contraintes de se prostituer. Et son attachement aux campagnes environnant alors Paris! Qu’elles nous manquent ! ☺
Cher Alexandra,
Merci pour votre repons! La Confession de Claude est pour moi un livre dragon, mais interessant, parce-que comme Claude Roy definit dans un essai, c’est le seul document autobiographique de Zola, base sur son relation avec la prostituee Berthe. La Confession (Roy) serait un pendentif de le docteur Pascal, son dernier roman. Ici on reconnait aussi Zola en Pascal, mais comme dans tout le cycle il procede comme un scientifique dissequant.
Roger Ikor a fait valoir Zola est le premier a utiliser la langage de la vie quotidienne et que le romancier moderne lui est redevable. Je ne sais pas quoi dire sur la langue de Zola, c’est directif, efficace et compact, mais parfois (peut-etre a cause de ca) ses livres semblent des pieces de theatre bon marche, vaudeville.
Il-y-a beaucoup d’improbabilites comme un deus-ex-machina. Jean, dans la Debacle (un des meilleurs romans, tres imposant!), rencontre Maurice dans la vaste de Paris et le tue d’un coup de son baionnette.
Finalement: l’ambiance a la Confession m’a rappele le roman gothique, mais aussi le sinistre et satanique de Baudelaire, Laurence la Jeanne Duval de Zola.
Les ` et ^ ne travaillent pas, excuse!
Jan Buter