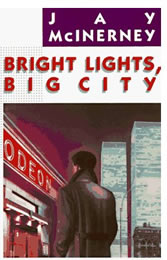 Journal d’un oiseau de nuit de Jay McInernney paru en 1984 est un livre culte, particulièrement loué en France par Nicolas Rey ou Frédéric Beigbeder (voir son commentaire sur le livre ci-dessous). Compagnon de bringue de Bret Easton Ellis pendant leurs folles nuits de jeunesse, ils étaient alors les jeunes auteurs en vue des années 80, surnommés le « brat pack » (la meute des sales gosses).
Journal d’un oiseau de nuit de Jay McInernney paru en 1984 est un livre culte, particulièrement loué en France par Nicolas Rey ou Frédéric Beigbeder (voir son commentaire sur le livre ci-dessous). Compagnon de bringue de Bret Easton Ellis pendant leurs folles nuits de jeunesse, ils étaient alors les jeunes auteurs en vue des années 80, surnommés le « brat pack » (la meute des sales gosses).
Le héros de « Bright lights, big cities » (son titre original) ressemble sans doute à ce qu’ils étaient alors. Une grâce nonchalante, un sens de la formule mordant, un goût pour les nuits interlopes, les aventures ou rencontres inattendues qu’elles réservent et un ennui profond pour tout travail alimentaire. L’auteur, alors âgé de 27 ans, nous plonge dans la vie d’un jeune New-yorkais s’enivrant des nuits mondaines et décadentes de New-york pour tenter d’oublier l’ennui mortel de ses journées passées à relirer et corriger les articles abracadabrants des journaliste du « Grand Magazine » où il travaille, ou encore sa rupture avec la belle Amanda mannequin de son état… Ce « blues » d’un jeune-homme qui ne croit plus à grand-chose s’arracha à vingt mille exemplaires par semaine (pour atteindre très vite le million d’exemplaires) et devint la bible de toute une génération. « New York en intraveineuse dans une improvisation virtuose comme un solo d’acid jazz noctambule et désenchanté », décrit le Figaro Magazine.
 Entièrement écrit à la deuxième personne du singulier, ce roman vous happe dés la première ligne par son style percutant et vif. L’humour cinglant de l’auteur fait mouche et vous accroche de la première à la dernière page.
Entièrement écrit à la deuxième personne du singulier, ce roman vous happe dés la première ligne par son style percutant et vif. L’humour cinglant de l’auteur fait mouche et vous accroche de la première à la dernière page.
Tout commence dans une boîte de nuit où le héros tente de se débarrasser d’une fille chauve, après avoir carburé au champagne dans les beaux quartiers de l’Upper East side, entraîné par son ami Tad (son « moi idéal » ou son « double infernal » décrit-il), sorte de Gatsby le magnifique moderne, puis dégringolé du pavé au fond d’un caniveau avant d’échouer sur ce dance-floor où il terminera la nuit dans les toilettes à sniffer quelques rails en compagnie de créatures de rêve tout aussi shoutées…
« Drogue, délice, décadence », résume-t-il. Une seule règle : « Celle du mouvement perpétuel, un verre à chaque halte. Se déplacer en permanence car c’est toujours ailleurs qu’on s’éclate plus.« . Un rituel qu’il ne manquerait pour rien au monde et qui l’aide à affronte la dure réalité des matins durs aveuglants, lunettes Ray ban sur les yeux, du métro, du beignet arrosé d’un café et de la course pour ne pas être en retard au « Grand Magazine ».
Son job où il ronge son frein en tant que relecteur-correcteur au « Service de vérification des faits », lui qui rêve au contraire d’écrire des fictions ! Un service aussi kafkaïen qu’hilarant. « Sitôt dans le hall, ta gorge se déssèche, ton plexus se serre à l’idée de ce qui t’attend. Voilà exactement ce que tu éprouvais en allant à l’école, le lundi matin, entre l’angoisse de ne pas avoir terminé tes devoirs et celle de ne pas savoir où t’asseoir à la cantine. » Sa mission ? S’assurer de la véracité et du bon orthographe des informations contenues dans les articles.
 Et justement sa supérieure, Clara, qu’il surnomme « La terreur » lui confie un article sur les dernières élections en France. Autant dire un vrai défi pour lui qui baragouine à peine la langue même si son CV affiche fièrement un « bilingue français »… Avec un art de la dérision hilarant, il dépeint ses tentatives pour démêler le vrai du faux de cet article réalisé par un piètre journaliste qui affirme par exemple que le gouvernement français détiendrait la majorité du capital de la Paramount…, tout en contant ses mésaventures au « royaume de la vérification des faits », parmi des collègues hauts en couleur (« Le Druide » son patron sage et flegmatique, Rittenhouse, un rond de cuir surrané arborant des noeuds papillon improbables…) où il passe sans cesse pour le bouc-émissaire des services plus nobles comme le « Service littéraire » : « Je ne fais que mon boulot et il ne me plait pas plus que vous« , voudrait-il leur dire quand ce ne sont pas les lecteurs qui l’assaillent de courrier pour contester l’existence d’une variété de pinsons dans le Connecticut… Une ambiance de bureau loufoque qui rappelle un peu celle du film Brazil de Terry Gilliam.
Et justement sa supérieure, Clara, qu’il surnomme « La terreur » lui confie un article sur les dernières élections en France. Autant dire un vrai défi pour lui qui baragouine à peine la langue même si son CV affiche fièrement un « bilingue français »… Avec un art de la dérision hilarant, il dépeint ses tentatives pour démêler le vrai du faux de cet article réalisé par un piètre journaliste qui affirme par exemple que le gouvernement français détiendrait la majorité du capital de la Paramount…, tout en contant ses mésaventures au « royaume de la vérification des faits », parmi des collègues hauts en couleur (« Le Druide » son patron sage et flegmatique, Rittenhouse, un rond de cuir surrané arborant des noeuds papillon improbables…) où il passe sans cesse pour le bouc-émissaire des services plus nobles comme le « Service littéraire » : « Je ne fais que mon boulot et il ne me plait pas plus que vous« , voudrait-il leur dire quand ce ne sont pas les lecteurs qui l’assaillent de courrier pour contester l’existence d’une variété de pinsons dans le Connecticut… Une ambiance de bureau loufoque qui rappelle un peu celle du film Brazil de Terry Gilliam.
Bref,l’épanouissement professionnel n’est pas au rendez-vous pour ce jeune dandy new-yorkais qui se rêve en écrivain, fonction autrement plus palpitante et glorieuse…
La nuit (« là où il y a de la poudre à rafler, des verres à siffler, des femmes à Alla-gâcher ») et l’exploration du terrain de jeu de la grosse pomme (des buildings de Madison Avenue aux rues sordides du Lower East Side…) constituent donc son échappatoire où il tente aussi d’oublier son divorce imminent avec la belle Amanda, « aux pommettes néo-classiques », mannequin de son état.
« Les choses évoluent, les gens changent« , lui a-t-elle déclaré en guise de jugement sans appel. « Tu as pensé à la violence, au vain espoir d’une réconciliation. Mais il ne te reste à présent que l’espoir de voir ta vie se faner sous tes yeux, comme un livre lu trop vite, qui n’aura laissé qu’une poussière d’émotions et d’images destinées à s’effacer, pour n’être plus qu’un nom dans ta mémoire« . La rencontre de Vicky, cousine de « Tad le magnifique », marquera-t-elle un nouveau départ ?
 Ce journal d’un oiseau de nuit est une ébullition permanente, nourrie de la frustration et de l’énergie de la jeunesse et de la ville new-yorkaises. Le tout servi par un humour décalé et élégant, rehaussé d’un style vif comme le rythme trépidant de la ville.
Ce journal d’un oiseau de nuit est une ébullition permanente, nourrie de la frustration et de l’énergie de la jeunesse et de la ville new-yorkaises. Le tout servi par un humour décalé et élégant, rehaussé d’un style vif comme le rythme trépidant de la ville.
McInerney a réussi à créer un personnage à la fois loser magnifique, frimeur et attachant grâce à un « cynisme tendre » (dont la scène du dîner avec sa collègue Megan constitue l’apogée).
Considéré comme « le manifeste littéraire d’une génération » et plébiscité par les plus grands auteurs lors de sa sortie (de Tobias Wolff à Raymond Carver en passant par George Plimpton…) dans la lignée du « dirty realism« , il constitue à n’en pas douter un incontournable des bibliothèques contemporaines ! [Alexandra Galakof]
Lire aussi : la chronique « Trente ans et des poussières » de Jay Mc Inerney
Deux ou trois choses que l’on sait de lui :
McInerney se plaint que son Journal d’un oiseau de nuit a souvent été vu comme un « guide pour le monde de la mode, la vie nocturne New Yorkaise et la quête du glamour. » Alors qu’il a plutôt cherché à « avancer une modeste critique d’un temps où un acteur est président, où on demande leurs opinions aux top models et où aller dans un nightclub est vu comme une réussite significative. » A noter que l’auteur s’est inspiré de sa propre expérience au New-Yorker où il était commis aux « basses œuvres » pour écrire son roman. A propos de sa comparaison récurrente avec son cadet Bret Easton Ellis, il répond : « J’adore ce qu’écrit Bret ! Il a publié, un an après mon Bright light, big city, Less than zero que la critique a salué comme un nouveau Bright light… (rires). On est devenus amis par la suite, mais son univers est beaucoup plus sombre que le mien, plus « sex, drugs and rock n’ roll ». Comme lui, j’ai essayé dès les années 80 de décrire une certaine frange des américains, bien des clichés à la Beverly Hills. » (Source : Livresse)
Extraits choisis :
« Tu as toujours rêvé d’écrire Dans ton esprit, ton boulot au Magazine ne devait être qu’un premier pas vers la célébrité littéraire. Ta prose était bien supérieure, et de loin, à celle qui paraissait chaque semaine dans le journal. Quand tu envoyas tes textes au service littéraire, ils te revinrent avec des notes polies du genre : « Ne nous conviennent pas à l’heure actuelle, mais merci de nous les avoir proposés. » Tu tentas d’interpréter. Que signifiait réellement, par exemple, l’expression : « à l’heure actuelle » ? Fallait-il entendre par là que tu devrais les leur proposer ultérieurement ? Ce ne fut pas tant ces notes que l’effort même d’écrire qui te découragea. Tu t’es toujours figuré être un véritable écrivain, rongeant son frein au service de vérification des faits. Mais entre ton travail et ta vie quotidienne, il ne te restait guère de temps libre pour disséquer à loisir tes émotions dans le secret de ton cabinet. »
« A deux reprises dans l’après-midi, tu appelles l’auteur de l’article pour lui demander quelles sont ses sources. la première fois, tu lui énumères toute une série d’erreurs flagrantes, dont il convient bien volontiers.
« D’où tenez-vous que le gouvernement français possèderait la majorité du capital de la Paramount ?
– Ce n’est pas le cas ? Ah ! merde ! Faites sauter ça.
-Les trois paragaphes suivants dépendant de cette assertion.
– Bon sang ! Qui a bien pu me raconter ça ? »
Au terme de votre seconde conversation, il semble réellement contrarié, comme si toutes les erreurs étaient de ton cru. C’est toujours comme ça, avec les journalistes : plus ils dépendent de toi, plus ils t’en veulent.«
Voir aussi : le site officiel de Jay McInerney













1 Commentaire
Frédéric Beigbeder a élu ce livre comme l’un de ses livres cultes et le commentait en ces termes :
« Vingt-cinq années ont passé depuis la publication de Bright Lights, Big City chez Vintage le 12 août 1984. Ce quart de siècle écoulé nous permet d’y voir un peu plus clair sur l’entrée en littérature de Jay McInerney. L’immense succès du livre, son adaptation (ratée) au cinéma avec Michael J. Fox dans le rôle principal, la notoriété postérieure de son auteur et sa vie privée agitée ne doivent pas faire oublier la force initiale de ce texte corrosif, dont l’émotion repose sur une sorte de romantisme enfoui, de désespoir pudique, comme une fleur fanée à la boutonnière d’un smoking puant la cigarette et le vomi.
Il porte le titre d’un blues de Jimmy Reed datant de 1961 dont le premier couplet pourrait être traduit ainsi : “Les lumières étincelantes de la grande ville sont montées à la tête de ma meuf ” (“Bright lights, big city gone to my baby’s head ”). La première traduction française du roman s’intitulait Journal d’un oiseau de nuit, ce qui est moins bien que "Lumières étincelantes, Grande ville". Il est difficile d’exprimer ce que j’ai ressenti la première fois que je l’ai lu (en Livre de Poche) : je commençais à peine à sortir des rallyes du XVIème siècle et c’était la première fois que quelqu’un décrivait avec autant d’acuité la folie froide de certaines boîtes de nuit où l’on entendait les Talking Heads (à Paris, les Bains-Douches ont ouvert la même année).
Le ton blasé et ironique du livre reflétait parfaitement le snobisme autodestructeur des bourgeois urbains que je côtoyais. L’errance d’un écrivain sans nom était rédigée à la deuxième personne, au présent de l’indicatif, comme dans La Modification de Butor, mais en plus cool (l’anglais « you » s’employant autant au singulier qu’au pluriel, la traductrice Sylvie Durastanti a fort justement opté pour le tutoiement en français.) La femme du héros, Amanda White, une superbe blonde dénichée à Kansas City, l’a quitté mais il n’en parle à personne, sauf à Tad, son ami drogué.
On finit par comprendre qu’elle avait entamé une carrière de mannequin et l’a abandonné dès que les affaires se sont mises à marcher pour elle. C’est donc bien la ville et ses tentations « glamour » qui viennent à bout de l’amour (comme le titre le laissait supposer). Et les noctambules frénétiques sont toujours des gens qui cherchent à oublier quelqu’un.
L’année suivante, Bret Easton Ellis publiera Less Than Zero, équivalent californien de cette sombre déambulation. Les deux livres décrivaient à peu près le même mode de vie d’enfants gâtés des eighties : soirées décadentes, rails de cocaïne ("J’ai de plus en plus l’impression de passer la moitié de ma vie aux chiottes "), sexe sans sentiments, vacuité de la société de consommation. Comme il arrive souvent avec les satiristes, le public a pris pour un éloge de l’hédonisme ce qui en était la dénonciation acide.
Et les deux auteurs, très jeunes, sont devenus en Amérique le symbole de ce qu’ils entendaient stigmatiser. Peu importe ce malentendu : autopsie d’un deuil amoureux, portrait d’un luxe qui court à sa perte, Polaroid de la solitude américaine, Bright Lights, Big City, tout comme Gatsby le magnifique, doit être considéré comme un roman engagé. Son influence sur la société, la culture et la jeunesse du monde entier ne fait que commencer. »