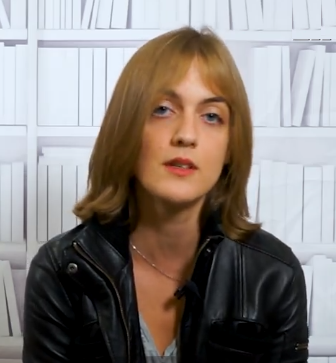 Désintégration d’Emmanuelle Richard est déjà le 3e roman de cette jeune auteur alors âgée de 33 ans lors de sa sortie en 2018. Originaire de la banlieue parisienne, elle est apparue sur la scène littéraire en 2015 avec un premier roman déjà remarqué, La légèreté, sur des vacances adolescentes sur la huppée Ile de Ré qui, outre le récit d une première fois, abordait déjà la question qui hante son oeuvre, celle de la honte ou plutôt du complexe voire frustration social(e). Elle enchaîne haut et fort en 2016 avec Pour la peau, un roman d' »amants maudits et perdus » entre un ex toxico d’âge mur pas encore guéri de son ex et de ses addictions et une jeune femme désillusionnée et précaire qui se cherche. Nouvelle voix de la génération Y aussi fascinante que percutante, elle mêle oralité et puissance d’évocation, même si inégale et parfois poussive -avec quelques anglicismes ridicules-, avec un sens esthétique de la mise en scène textuelle et visuelle particulièrement intéressant et captivant. Parrainée par Jaenada et Olivier Adam qui l’a personnellement recommandée aux éditions de l’Olivier, elle partage leur style intimiste, voire autobiographique, et surtout l’obsession des classes sociales de ce dernier, tout comme Annie Ernaux, une de ses influences revendiquées (dont elle reprend d’ailleurs l’expression « venger ma race » mais sans la citer)… avec le rap!, entre autres.
Désintégration d’Emmanuelle Richard est déjà le 3e roman de cette jeune auteur alors âgée de 33 ans lors de sa sortie en 2018. Originaire de la banlieue parisienne, elle est apparue sur la scène littéraire en 2015 avec un premier roman déjà remarqué, La légèreté, sur des vacances adolescentes sur la huppée Ile de Ré qui, outre le récit d une première fois, abordait déjà la question qui hante son oeuvre, celle de la honte ou plutôt du complexe voire frustration social(e). Elle enchaîne haut et fort en 2016 avec Pour la peau, un roman d' »amants maudits et perdus » entre un ex toxico d’âge mur pas encore guéri de son ex et de ses addictions et une jeune femme désillusionnée et précaire qui se cherche. Nouvelle voix de la génération Y aussi fascinante que percutante, elle mêle oralité et puissance d’évocation, même si inégale et parfois poussive -avec quelques anglicismes ridicules-, avec un sens esthétique de la mise en scène textuelle et visuelle particulièrement intéressant et captivant. Parrainée par Jaenada et Olivier Adam qui l’a personnellement recommandée aux éditions de l’Olivier, elle partage leur style intimiste, voire autobiographique, et surtout l’obsession des classes sociales de ce dernier, tout comme Annie Ernaux, une de ses influences revendiquées (dont elle reprend d’ailleurs l’expression « venger ma race » mais sans la citer)… avec le rap!, entre autres.
Je n’ai jamais eu le sentiment de vivre une vraie vie. C’était un fixatif auquel je n’avais pas accès. Je multipliais pourtant les tentatives pour sortir de moi-même en prenant des risques et en allant au-devant, des choses, des gens, en allant les chercher, puisque j’avais compris qu’ils ne viendraient pas à moi, que rien ni personne ne viendrait me chercher, ni ici ni ailleurs, contrairement à ce que j’avais si longtemps espéré, il me faudrait aller à eux, aller de l’avant et au-devant pour les prendre et les rencontrer -choses et gens.
A la suite de ses aînés de Génération X aux Tribulations d’un précaire d’Ian Levison (elle cite aussi Eureka Street), Désintégration* raconte le quotidien d’une frange de la génération Y (elle est née en 1985), à Paris, mais qui finalement ressemble fort à celle de la génération précédente : ses errances, précarité, fragilité économique et affective, ennui d’étudiante puis frustrations de jeune diplômée sur un marché du travail hostile et rébarbatif, victime de déclassement social, ses histoires d’amour bancales et surtout d’un soir qui laissent souvent un goût amer et surtout sa haine des nantis, des « fils de » qu’elle croisent dans les arrondissements cossus de la « grande ville » comme elle l’appelle et avec qui elle cohabite même un temps. Ce dernier thème qui gonfle au fil des pages et qui finit par prédominer malheureusement témoigne surtout de l’envie, la jalousie qui l’étreignent voire l’étouffent et l’aveuglent à leur égard. C’est d’ailleurs là où malheureusement le trait de Richard perd en finesse et devient d’une lourdeur écrasante, tout comme son mentor Olivier Adam qui a le même travers. Caricaturale, on perd la justesse et la nuance avec cette “rage” sociale qui semble plus ou moins sortir de nulle part et s’auto-nourrir sans réelle cause apparente si ce n’est ses propres complexes personnels, aux relents révolutionnaires de pacotille (“Je les hais pour leurs cous blancs à guillotiner”)… Un défaut sauvé par sa voix, son style qui accroche même si le fond verse parfois dans le regrettable poussif, simpliste et manichéen populisme sur un air de « c-la-fôte-aux-riches« ). On la préfère quand, plus touchante, et faisant preuve de justesse, elle évoque sans fard sa solitude, sa quête amoureuse, sociale et d’une « vocation », d’une « place » tout simplement.
Solitude et quête de l’autre
Thème (cliché) éternel et moteur principal avoué et assumé de l’héroïne qui se qualifie « d’affamée d’amour » : la recherche de l’amour, d’une âme en mesure de combler sa solitude débordante, l’anime avant tout, du moins c’est ce qu’elle constate après avoir obtenu le succès littéraire tant attendu (la quête de reconnaissance socio-professionnelle faisant aussi partie jusqu’alors aussi de ses attentes), mais déjà blasée elle réalise que l’essentiel finalement n’est pas là pour elle :
“Je ne sais plus quand j’ai cessé de croire que tout ce fatras de tropées me rendrait aimable et me permettrait de trouver l’amour véritable, celui d’une vie, car je ne voulais plus tous les hommes, je voulais un homme à moi seule et qui le resterait jusqu’à la fin et inversement”
La description du gouffre de solitude tant intellectuelle qu’affective qu’elle subit depuis l’adolescence est particulièrement marquante par la force d’évocation de ses images : “j’essayais de m’épousseter des brins de paille et de cette solitude sans fond ni nom qui me colle au dos comme une poisse, goudron et plumes depuis toujours”, ou encore durant l’anniversaire collectif de ses 18 ans : “Je pensais à mes parents, à la manière dont ils devaient dormir profondément sans se douter le moins du monde de mon isolement ni dans quelle mer de solitude j’étais encore en train de nager une brasse molle.”
Elle restitue aussi bien les compromis qu’il faut parfois faire pour y échapper et subir des relations amicales ou amoureuses par défaut donnant pas forcément satisfaction mais qui comblent le vide, faute de… :
“je n’avais pas assez de force de caractère pour cela, c’est à dire que je n’avais pas encore la force de rompre les seuls liens que l’entretenais durant cette période de ma vie”
“il ne savait pas que je passais mon temps à suivre n’importe qui tellement j’étais seule”
“alors j’ai fait ça toute ma vie, tenter d’aller chercher des gens, des alliés, les contacter pour essayer de me recomposer une famille en émettant des signaux de fumée.”
Sa vision du désir et de la sexualité semblent assez symptomatiques de l’époque et pas forcément très réjouissante… Même si totalement libérée et décomplexée, ce qui lui vaut d’ailleurs la réprobation masculine la taxant de « fille facile » ce qu’elle a l’intelligence d’ignorer et même de provoquer (“être mal perçue pour l’usage que je faisais de mon corps m’était vite devenu indifférent, voire honorifique, après toutes ces années à faire tapisserie”), elle ressent surtout une insatisfaction quasi permanente souvent synonyme de renoncement à son propre plaisir pour se soumettre à celui masculin. Elle admet ainsi qu’elle cède souvent aux insistances masculines par “lassitude”, ce qui laisse songeur à l’heure où la notion de “consentement” occupe le devant de la scène:
“je finis par le laisser coucher avec moi. Cela s’accomplit dans un mélange d’ennui, de fatigue, de curiosité faible et d’envie molle pour ce qui me concernait.”
“Je le trouvais collant, je voulais que ça finisse. Je voulais qu’il me fiche la paix.”
“Par curiosité sociologique, goût de la gentillesse et envie de douceur, j’ai revu un peu le fils M. en dépit du sexe nul. On ne l’a pas refait. Je voulais juste ses bras.”
Dans ce ballet éphémère de corps qui se croisent sans attachement ou même considération, lorsqu’elle rencontre “quelqu’un qui s’intéresse à ce qu’[elle] avait dans la tête”, elle qualifie ce fait de “première” et révèle même qu’avant cela, elle “n’avait aucune idée de ce que signifiait être traitée correctement par quelqu’un” ou encore “Pour la première fois de ma vie, j’avais l’intuition de me trouver face à quelqu’un qui ne profiterait pas de mes faiblesses pour me blesser et ne me tomberait pas dessus dés que je baisserais les armes.”
Une éducation sentimentale violente où le corps de la femme n’est qu’un territoire à conquérir et à faire « tomber » :
« Moi qui n’avais appris qu’à me défendre, à chuter et à perdre, ou bien à attaquer quand il fallait, c’étaient les seules choses que m’avaient enseignées la vie, moi qui savais à peine ce qu’était la douceur (…)”!
Je pense ici à sa consoeur sensiblement du même âge la New yorkaise Lena Dunham (1986, « Not that kind of girl« ), livre un peu fouillis et sans recherche littéraire mais qui comporte malgré tout quelques morceaux d’anthologie dignes d’un Moins que zéro de Bret Easton Ellis, notamment le récit épique de ses déboires sentimentaux avec de parfaits gougeâts et de coïts foireux.
L’héroïne de Richard admet toutefois son penchant aux mauvais garçons, « un fils de taulard, un balafré bien marqué (…) un « Mauvais cheval. Outsiders. Sniper et franc-tireur », et aime « se jeter dans la gueule du loup » comme le disait aux même âges, deux décennie plus tôt, la chinoise Mu Zimei
Trois romans en un : une structure un peu « fourre-tout »
Désintégration brasse beaucoup de themes, peut-être trop. Il aurait sans doute gagné à être plus resserré sur une expérience en particulier. En effet si sa structure est originale, elle peut aussi verser dans l’anarchique avec des zooms avant et arrière constants entre souvenir de jeunesse, présent et futur, triple narration de la fin de son adolescence, vie d’étudiante en coloc’ puis jeune active en galère à laquelle se superpose encore la voix de l’auteur à succès ou du moins « en vogue », reconnue par la critique qu’elle est devenue et enfin pour finir une succession de pseudo chroniques culturelles/résumés d’une série de films/livres** du moment qu’elle a aimés ou non qui semblent avoir été juxtaposés là pour faire un peu de remplissage (??). Un choix audacieux mais qui à vouloir trop dire ne rentre pas assez en profondeur dans l’une ou l’autre de ces périodes de vie et laisse un goût de superficialité et d’inachevé. Nous avons quasiment ici 3 romans en 1, écueil qui n’était pas présent dans Pour la peau par exemple, resserré à l’extrême en revanche, et donc plus réussi sur ce plan (et le reste d’ailleurs, hormis sa fin qui joue les prolongations répétitives alors qu’une coupe franche et nette 10 pages plus tôt aurait été parfaite!).
Le télescopage avec sa vie post succès littéraire gâche en particulier la sève plus intéressante du récit de ses années d’étudiante en galère et en coloc avec quelques fils bien nés du XVIe arrondissement.
Je ne baissais pas les bras et faisais ce qu’il y avait à faire même si ce n’était pas chic (…) Je sentais alternativement la frite, le graillon, les textiles synthétiques. Je passais des UV. Je courais toujours après une vocation professionnelle ou quelque chose à moi et je multipliais les expériences (…) En réalité, je continuais de chercher cette chose qui serait rien qu’à moi et me rendrait le monde habitable, cabane portative.
Engluée dans le monde des sous-jobs et Quête d’une vocation
On aurait ainsi aimé être entraîné un peu plus en profondeur dans les coulisses de ses jobs de petite main sous payés, ses « Macjobs » comme les appelait déjà Douglas Coupland, qui doivent fourmiller d’anecdotes, comme celui d’aide-retoucheuse chez Celio par exemple, dont on aurait aimé en savoir plus et qu’elle enchaîne à reculon : ses relations à une clientèle irrespectueuse et méprisante qu’elle honnit ou ses collègues de misère souvent issus d immigration qui lui font office de « famille » dans la catégorie des « perdants économiques », la rendant « figure d’exception » et donc convoitée des employeurs, elle la blondinette aux yeux bleus à l’air (faussement) soumis.
Elle livre d’ailleurs à ce propos un mode d’emploi au cynisme mordant des qualités et du type de réponses à adopter lors des entretiens de recrutement : “Je savais ce qu’il fallait répondre lors d’un entretien d’embauche, quels silences caler à quels moments préciset à quels autres il fallait sembler tour à tour réservée, dynamique, motivée, enthousiaste, impliquée et docile.”
Elle souligne aussi bien le fossé avec ceux qui ont réussi et qui n’ont jamais connu de l’intérieur les affres de ces emplois de galère et qui les regardent de haut sans réaliser que pour certains il n’existe pas d’autre perspective : “ce qu’ils appellent des ‘petits boulots’ ou des ‘boulots de merde’, sans (…) jamais ni réaliser que ces boulots qu’ils nomment de merde, tous autant qu’ils sont, journalistes ou gens de l’édition ou artistes de bonne extraction, parvenus méprisants ou même ceux qui ne les ont occupés qu’un temps très court, sans jamais imaginer possible le fait d’y rester eux, sans jamais intégrer ces emplois-là comme avenir réel et envisageable pour eux-mêmes, que ces ‘boulots de merde’, donc constituent les emplois tout court d’un certain nombre de personnes.”
De même la description de sa « lutte » acharnée pour découvrir une occupation un tant soit peu épanouissante est bien rendue et résonnante sur le décalage qui attend beaucoup de jeunes diplômés entre leurs aspirations, les promesses de leur diplôme et la réalité souvent terne si ce n’est déprimante d’un monde du travail et de l’entreprise qui placent bien souvent la rentabilité et le profit en première ligne :
“Je voulais parvenir à un mode de vie où me lever le matin serait une action que je réaliserais sans dégout”
Malgré tout, elle croit en la valeur « travail » et surtout de l’expérience et tente de tirer partie de ce creuset pour s’enrichir, si ce n’est financièrement au moins intérieurement en tant qu’auteur et finir par trouver sa place:
“Je pensais que l’on n’était pas un véritable écrivain tant que l’on avait pas été dans le monde, or être dans le monde pour moi c’était travailler, et je croyais que travailler c’était s’agrandir; j’étais convaincue qu’à force de travailler, de multiplier les expériences, j’allais finir par trouver ce que je voulais faire de ma vie jour après jour après mois après année et qui serait plus qu’un métier: une vocation. »
Cette bonne volonté finira malgré tout par se trouver usée sous le poids de la pénibilité et des difficultés économiques. L’expérience minante de son couple avec un autre jeune en décrochage scolaire et également employé surexploité des grandes chaînes tertiaires, tentant de sortir la tête de l’eau mais restant toujours dangereusement à découvert, est particulièrement révélatrice.
A force d’échecs, elle se met donc à nourrir une dent, une rage même contre “filles et garçons qui ‘font quelque chose dans la vie’, la plupart d’entre eux prêts à avancer à grands coups de dents, à tuer pour ça (…) grouillant, rampant, m’encerclant (…) ils faisaient tous quelque chose, ils avaient tous un talent ou une velleité au fond de leur poche, (…) qu’ils dégainaient si vous parliez plus d’une demi-minute avec eux”.
On regrette toutefois qu’elle ne fasse que survoler ce tourbillon d’expériences éphèmères et les balaie d’impressions générales.
Enfin, la partie sur ses débuts de succès littéraire apparaît assez artificielle et ne colle pas vraiment avec le reste. L’entrevue avec le réalisateur « homme fleur », en particulier, traîne en longueur et n’apporte pas grand chose voire devient franchement ennuyeuse et semble n’être là que pour satisfaire la fascination amoureuse de l’ auteur pour cette figure. Même si la grâce de son style dans ses descriptions de la tension sociologie érotique qui s’exerce entre eux parvient à sauver un peu ces pages superflues.
« Le labeur difficile, éprouvant et jamais terminé de la construction de soi-même »
Un des thèmes les plus intéressants de ce roman de formation réside sans doute la réflexion qu’elle livre sur la construction personnelle d’un être, particulièrement intense et violente dans la jeunesse où l’on se débat entre les modèles de réussite et ses propres aspirations pas toujours concordantes, où il faut réussir à s’inventer finalement. Elle, l’ex-étudiante en lettres déçue de ses études qu’elle se force à terminer, espérant qu’au bout se trouvera enfin le sésame qu’elle attend et qui n’y est pas, analyse avec justesse ce sentiment de perdition et de désespoir qui peut étreindre lorsque la vie, l’avenir semblent ne rien avoir à offrir, quand aucun de ses moules ne vous sied et que l’isolement vous enserre :
Je cherchais (…) un cadre, un passeur, un référent, un grand-frère ou un collectif ; une organisation transmettant des savoirs et du savoir-faire; quelqu’un pour me dire qu’on pouvait faire différemment, vivre autrement, en parallèle ou à rebours si on voulait; quelqu’un qui m’assurerait que quelque chose me convenant en propre était envisageable ; une structure ou une famille réinventée; je cherchais un visage, un refuge, un sens, ou simplement quelqu’un à qui parler (…)
Elle ne se laisse pas pour autant abattre et son héroïne qu’elle a cherché volontairement à montrer combative se lance malgré tout à corps perdu dans la meute, dans la foule, celle de la fac, des boîtes de nuit, des magasins qui l’exploitent sans ménagement. Rester active pour rester vivante en somme, en contact avec le monde aussi peu accueillant soit-il, et tenter de se forger dans ce chaos en dépit de tout et affuter ses armes :
Je préférais de loin subir un sentiment d’indignité désagréable mais passager, sentiment qui me permettrait de ramasser un petit caillou d’expérience supplémentaire, au détour de telle ou telle situation, plutôt que de rester dans ma chambre.
ou encore :
Chaque caillou d’expérience collecté était une kalachnikov pour l’avenir, une clé pour la liberté future
Le fait d’être une femme et jeune ne l’empêche d’ailleurs pas de revendiquer sa part du monde et de se battre pour gagner celle-ci, de vaincre sa honte et son sentiment d’exclusion. Cette « prise de pouvoir » qui la hante et qu’elle goûtera ensuite, avec cynisme et dégoût presque paradoxalement, quand toutes les portes finiront par s’ouvrir après sa publication.
Bien sur que j’étais fière et alors ? Qui allait croire en moi si je ne le faisais pas, qui me donnerait la parole si je ne la prenais pas ?
Elle fait écho à d’autres voix feminines de sa génération et sensiblement de son âge, dans une moindre mesure le petit roman graphique « Les adultes n’existent pas » de Sarah Andersen (1992) pour le côté « inadaptée sociale », ou encore côté francais la parisienne Léa Frédeval (1990) et son essai « Les affamés: Chroniques d’une jeunesse qui ne lâche rien » qu’elle a ensuite adapté en film, également sans style mais néanmoins éclairant sur une certaine mentalité/complainte des « jeunes d’aujourd hui » s’estimant lésés, exploités, mal lotis (également discours tenu par Richard dans Désintégration, de façon particulièrement lourde parfois donc, écueil dont était exempt Pour la peau, beaucoup plus réussi à mon sens de façon générale comme dit et que je vous encourage à lire également.
Frédeval se plaint notamment de ne pas pouvoir payer son loyer parce qu elle a flambé son salaire pour une paire de baskets… Matérialisme et superficialité aigus au 1e degré qu’on retrouve aussi chez Richard qui nous dit par exemple d’un ton larmoyant de ne pas « oser » s’aventurer dans les rayons du fond de Sephora comportant les cosmétiques de luxe car elle n a pas les moyens de se les acheter. Ce qui semble être, à la lire, le pire fléau qui puisse l’affecter d’autant qu elle insiste dessus…
Rien de bien nouveau depuis mai 68 ceci dit…
Article à suivre en cours de finalisation… [Alexandra Galakof]
* Titre en hommage au film de Philippe Faucon de 2012 auquel elle s’est identifiée pour son sujet sur l’exclusion et la haine qu’elle suscite (le second terme, autre film, sert d’ailleurs à intituler la dernière partie de l’ouvrage).
** On y reconnaîtra d’ailleurs une critique assassine du roman « Celle que vous croyez » de Camille Laurens (sans la nommer toutefois) qui apparaît totalement déplacée dans le roman mais qu’on ne résistera pas de livrer en extrait (voir dans les commentaires de l’article en lien). Il semble que Richard soit passé totalement à côté du vrai sujet du livre pour le réduire à une attaque anti-cougar dans la plus pure tradition misogyne et patriarcale… Dommage !
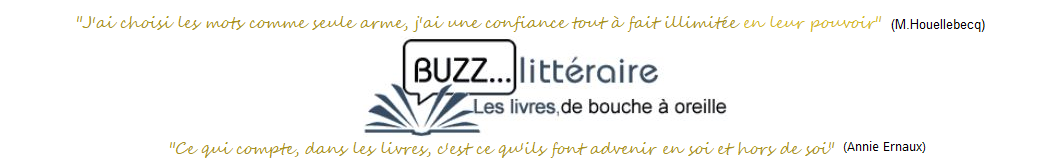












Derniers commentaires